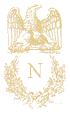
Bon Adrien Jeannot de Moncey né à Moncey, paroisse de Palise dans le Doubs, le 31 juillet 1754 (baptisé le 1er août), mort à Paris le 20 avril 1842), maréchal d’Empire, duc de Conegliano.
Fils cadet d’un avocat au parlement de Besançon, Bon Adrien passera sa petite enfance dans la propriété familiale à Moncey puis commence des études au collège de Besançon. Moncey était doté d’un caractère bouillant et d’une imagination guerrière. Son père prit grand soin de son éducation, mais ne put dompter son caractère ardent et indocile. Après avoir terminé des études incomplètes le jeune Moncey, bravant les préventions alors attachées aux jeunes gens qui s’enrôlaient comme simples soldats, s’échappa, en 1770, du collège pour s’engager dans le régiment de Conti-Infanterie, sans l’accord de son père, annonçant au sergent recruteur qu’il a 16 ans. Au bout de six mois, son père acheta son congé. Le jeune homme eut à peine passé un an dans sa famille, que le 15 septembre 1769, il s’engagea dans le régiment de Champagne où sa belle taille le fit aussitôt admettre au nombre des grenadiers. Ce fut en cette qualité qu’il fit la « campagne des côtes de Bretagne » en 1773, campagne mise en ouvre dans le but de les protéger contre les entreprises des Anglais. Cette espèce de campagne fournit à Moncey diverses occasions de donner des preuves de son intelligence et surtout de son amour pour la discipline.
Tous ses goûts l’entraînaient irrésistiblement vers les armes (ses oncles et cousins étaient officiers du roi et firent naitre en lui la vocation militaire), mais cette carrière ne pouvait mener à rien un simple roturier. Son père « le racheta » une seconde fois. Revenu à Besançon, Moncey parut enfin vouloir se conformer aux vues de son père, et se livra pendant quelques mois à l’étude du droit. Mais ce zèle dura peu. Il fallait à cette âme ardente une vie d’émotion et d’activité que les luttes paisibles du barreau ne pouvaient lui offrir. Dès la fin de l’année 1774, sa vocation l’emporta encore : il s’engagea dans le corps privilégié de gendarmerie de la Garde de Lunéville, troupe d’élite, où les simples soldats avaient rang de sous-lieutenants. Après quatre ans de service, il passa, le 20 août 1778, avec son grade de sous-lieutenant de dragons dans la légion des volontaires de Nassau-Siegen, ainsi appelés du nom de leur colonel. Allant d’unité en unité, prenant des congés, il sera alors qualifié d’« inconscient et léger » (jugement de 1779). Il devint lieutenant en second (1782), puis lieutenant en premier (1785). Ce régiment, au commencement de la Révolution, devint le 5e bataillon d’infanterie légère, et fut, dès la fin de l’année 1792, envoyé à l’armée des Pyrénées.
Commandant en chef de l’armée des Pyrénées-Occidentales
Moncey se montra partisan de la Révolution française. Nommé capitaine le 12 avril 1791, il commandait, au mois de juin 1793, le 5e bataillon d’infanterie légère devant Saint-Jean-Pied-de-Port. Depuis la malheureuse issue du combat de Château-Pignon (fatale journée qui ne fut point sans quelque gloire, grâce à la bravoure du capitaine Moncey), les troupes françaises, accablées par le nombre, attendaient sous le canon de cette place l’occasion de se venger. Le 5 février 1794, le général espagnol Caro, enivré du succès éphémère de son coup de main sur Château-Pignon, ayant rassemblé ses divisions, leur ordonna d’attaquer les Français dans leur camp d’Hendaye. Les deux partis firent des prodiges de valeur : la victoire flottait, indécise. Sur ces entrefaites, l’impétueux Moncey, investi depuis peu du grade de chef de bataillon à la tête de la 5e demi-brigade d’infanterie légère (26 juin 1793), qui, au bruit du canon et de la mousqueterie, avait quitté le lit de douleur où il était retenu, vola au secours de ses frères d’armes.
Sa rare intrépidité ne contribua pas médiocrement à l’heureuse issue de la bataille. Dans la position où se trouvait la France à cette époque, la prise du camp d’Andaye dit aussi « des sans-culottes », aurait pu avoir les plus funestes conséquences. Sa conservation, au contraire, maintenait les Français aux portes de l’Espagne. Pour le récompenser de sa belle conduite dans cette journée, les représentants en mission auprès de l’armée des Pyrénées-Orientales le nommèrent chef de brigade. Le Comité de salut public ne se contenta pas de confirmer sa promotion à ce grade élevé ; peu de temps après , il lui conféra celui de général de brigade (18 février), du fait du manque d’officiers supérieurs. Il est ainsi l’un des quatre futurs maréchaux d’Empire à avoir sauté le grade de chef de brigade (colonel) institué par le décret du 21 février 1793. Montrant au conseil de guerre tenu en juillet 1794 plus de confiance que le général Müller, commandant en chef, il préconisa l’offensive, vit ses idées eu partie adoptées, et fut nommé général de division et placé à la tête de l’aile gauche. Moncey exécuta très heureusement les mouvements qu’il avait conçus.
Moncey se distingua également à la prise de la Montagne de Louis XIV, à l’affaire des Aldudes, au siège de Tolosa. Jannot de Moncey, informé que les représentants le proposaient à la Convention nationale pour remplacer le général Muller au commandement supérieur de l’armée des Pyrénées, s’empressa de décliner un tel honneur, dans une lettre qu’il leur écrivit, et dans laquelle il déclarait, avec une rare modestie, que, n’ayant point les qualités nécessaires à un général eu chef, il était résolu à ne point accepter ce commandement. Les représentants n’en persistèrent pas moins dans leur projet; car, pour en finir avec l’Espagne, il fallait un second Dugommier, et Moncey fut définitivement choisi.
Voici en quels termes ils s’étaient exprimés dans leur rapport au gouvernement, sur la prise du Passage et de Saint-Sébastien : « Ce général a déployé, dans cette occasion, non seulement le courage, les talens, la prudence et la sagesse dont il a déjà donné des preuves réitérées, mais encore toute la grandeur, la majesté et la fierté républicaines. Ses propositions et ses réponses aux demandes qui lui étaient faites sont dignes de la cause qu’il défend, de l’armée qu’il commande et du peuple pour lequel il combat. » » Moncey céda lorsque les représentants lui remirent le décret de sa nomination, datée du mois de fructidor (9 août 1794). Dès lors, jaloux de justifier la confiance du gouvernement, il s’appliqua à terminer la lutte par un coup décisif. Dès le 17 octobre suivant, il répondit à cette promotion en battant les Espagnols à Villanova (aujourd’hui municipalité de la province de Huesca). La victoire, maîtrisée par la force des choses, mit néanmoins l’armée révolutionnaire en possession de la Navarre espagnole, hors la place de Pampelune ; en outre, 2 500 prisonniers, 50 canons, 2 drapeaux, différents magasins, les fonderies d’Orbaitzeta et d’Eguy, évaluées à 30 millions, furent le fruit des habiles combinaisons de Moncey. Moncey pénétra le 7 octobre 1794, dans la vallée de Bastan, à la tête de quatre colonnes. Cette vallée, d’environ six lieues de longueur, est entourée de hautes montagnes qui la resserrent dans une longueur très inégale. Il s’empara du col de Maya, puis il se dirigea vers la montagne des Quatre-Couronnes, en passant par Lesaka, pour tourner le camp retranché des Espagnols établi à Saint-Martial, dont l’artillerie formidable défendait le passage de la Bidassoa.
On s’imaginerait difficilement ce qu’il fallut de courage à ses soldats pour gravir cette terrible montagne des Quatre-Couronnes. Obligés de former une seule file sur une pente raide, coupée de précipices, ils se soulevaient, se poussaient l’un l’autre, s’accrochaient aux rochers avec les pieds et les mains. Enfin, cette espèce de Manoeuvre dura pendant six heures sous le feu de l’ennemi, qui, étonné de tant d’audace, finit par abandonner ses camps, près de 150 tentes, et se retira du côté d’Oyarson. Frégeville, à la tête de sa colonne, rivalisant de hardiesse, traversait en même temps le Bidassoa, ayant de l’eau jusqu’à la ceinture, sous le feu croisé de deux batteries ennemies. Tout-à-coup, Moncey, soutenu par Delaborde, apparut aux yeux des Espagnols sur le sommet des Quatre-Couronnes. À cette vue, ils comprirent qu’ils allaient être tournés, et, saisis d’épouvante, ils quittèrent leurs retranchements, dont ils firent sauter une partie, abandonnant leur artillerie, leurs munitions, leurs magasins, et s’enfuirent du côté d’Ernain. Après avoir fait sa jonction avec Frégeville à Oyarson, Moncey marcha sur Fontarabie, s’empara de cette ville (où il trouva d’immenses provisions), se dirigea ensuite vers le port du Passage et se rendit maître des hauteurs de San Sebastián. 3 000 hommes de l’armée espagnole s’étaient enfermés dans cette place. Latour-d’Auvergne, à la tête des grenadiers qui formaient l’avant-garde, eut mission de négocier la capitulation qui eut lieu en effet le même jour. Moncey établit son quartier-général à Elizondo (Navarre), dans la vallée de Baztan. Cette campagne, qui avait duré moins de cinq jours, le mit en possession de 200 bouches à feu, 12 000 fusils, plusieurs drapeaux, 20 000 tentes, 2 000 prisonniers, 30 navires chargés d’objets précieux et de munitions de guerre. 3 000 morts environ étaient restés sur le champ de bataille. Légèrement blessé à Roncevaux, le général y fit détruire la pyramide élevée par les Espagnols dans la plaine, en mémoire de la défaite essuyée par Charlemagne.
Le 28 novembre de la même année, un corps d’armée de 4 à 5 000 hommes, commandé par le général Ruby, fut mis en pleine déroute, et laissa 200 prisonniers, 4 drapeaux, 1 pièce de canon en bronze, l’unique de l’armée espagnole, 5 000 fusils ou carabines, 38 caissons, la caisse militaire, les magasins du quartier-général de Bergara et des munitions considérables. La prise des deux jolies villes d’Ascuetia et d’Aspeytia vint ajouter encore aux avantages obtenus à Bergara. Vers la fin du même mois, Moncey avait donné l’ordre d’occuper Castelon, village à une lieue et demie, à la gauche de Toloza, plongeant le chemin de Lecumberry ; mais l’ennemi avait eu le temps de s’emparer de cette position, où il était en force.
Cependant il fallait l’en déloger à tout prix. Le 1er bataillon des chasseurs basques, le 2e du Tarn et le 7e du Gers attaquèrent Castelon. Après un combat assez vif, les Espagnols se mirent en retraite, pendant laquelle ils éprouvèrent d’assez grandes pertes. On retrouva parmi les morts le colonel des Catalans. Moncey écrivit à la Convention pour lui annoncer le succès qu’il venait de remporter dans cette journée, et terminait sa lettre par ces mots : « J’espère que ce choc dégoûtera l’ennemi d’établir ses cantonnemens trop près des nôtres ; s’il s’y obstinait, nous l’en ferions repartir de rechef. » La neige qui couvrait les montagnes mit fin momentanément à la guerre. Durant cette trêve obligée, la cour d’Espagne, excitée par l’Angleterre, ordonnait de nouvelles levées, appelait la nation à une espèce de guerre sainte, changeait ses ministres et ses généraux, pendait les hommes qui lui étaient suspects, recevait de la Grande-Bretagne des promesses, et de la cour de Lisbonne l’assurance que 5 000 soldats portugais marcheraient incessamment vers les frontières de France. L’armée des Pyrénées-Occidentales, sous les ordres du général en chef Moncey, jouissait de l’admirable position qu’elle avait su conquérir ; composée de 76 bataillons, elle formait, au mois de février 1795, une ligne dont la droite, appuyée à la mer, se prolongeait jusqu’à la vallée d’Aspeylia ; le centre s’étendait dans les vallées de Lerín et de Bastan ; l’aile gauche rentrait ainsi sur le territoire de la République et s’adossait à la place de Villefranche. L’armée française occupait donc activement vingt lieues dans le pays ennemi, qui la pourvoyait des denrées de première nécessité. D’autre part, les postes du Passage et de Getaria assuraient la navigation de tout le golfe de Gascogne, tandis que les corsaires français interceptaient le commerce de la péninsule ibérique par de fréquentes captures.
Moncey vainquit le général Crespo près de Villaréal, à Mondragón et à Eyber. Cependant Crespo, forcé de fuir et redoutant que les Français ne marchent sur Poncorbo et ne s’emparent de ce boulevard de la Castille, chercha à les attirer sur un autre point. En conséquence il se porta vers Bilbao à marches forcées ; mais ce ne fut que pour l’abandonner au plus vite et courir définitivement au secours de Poncorbo, car l’invasion de l’armée républicaine s’étendit si rapidement qu’il craignit tout pour cette importante forteresse. Le 19 juillet 1794, les Français prirent possession de Bilbao, et se rendirent entièrement maîtres de la province de Biscaye. Ils trouvèrent dans Bilbao des magasins immenses en provisions de toute espèce.
Moncey conclut à San Sebastián un armistice, préliminaire du traité de Bâle, signé le 22 juillet 1795, par les délégués français et espagnols. Il revint alors en France pour y goûter quelque repos. Le 31 août 1795, il fut appelé au commandement en chef de l’armée des côtes à Brest. Ce poste était important : en même temps qu’il fallait surveiller les tentatives incessamment renouvelées sur nos côtes par les Anglais et les émigrés, il fallait mener à bien, en Bretagne, l’ouvre de pacification que Hoche venait de terminer dans la Vendée. L’esprit de modération et la générosité de cour qui ont toujours distingué Moncey lui facilitèrent l’accomplissement de sa tâche. Il consacra tous ses soins à faire disparaître les traces que les discordes politiques avaient laissées dans cette province. Après un an de séjour, il fut envoyé à Bayonne pour commander la 11e division militaire (1er septembre 1796). Il resta là dans une inaction qui dut lui être d’autant plus pénible qu’il voyait nos armées cueillir de nouveaux lauriers sur le Rhin, au-delà des Alpes et sur les bords de Nil. Moncey était peu solliciteur : il avait commandé en chef et avec éclat une armée qui n’existait plus, celle des Pyrénées ; avec elle il avait forcé l’Espagne à la paix ; il eût, désiré sans doute une position analogue dans une autre armée.
Le Directoire l’oubliait, il ne fit rien pour se rappeler à son souvenir. Après le coup d’État du 18 fructidor an V, des rapports de police le signalèrent comme royaliste ; les agents des Bourbons le traitaient du moins comme tel et le désignaient, dans leurs rapports, sous le surnom « Laurens 1262 ». Bien qu’il fût étranger à ces menées, le Directoire le destitua (26 octobre 1797). Il vécut deux ans dans une obscure retraite, vint à Paris solliciter la justice qui lui était due, et, à force d’instances, fut rappelé à l’activité le 2 septembre 1799. Dans une lettre du 15 novembre suivant, à Berthier, il se plaignait de n’avoir encore reçu ni destination, ni traitement. Cette disgrâce lui fut comptée par les Bourbons en 1814, qui lui en surent autant de gré que s’il l’avait méritée.
Campagne d’Italie (1799-1800)
Lors du coup d’État du 18 brumaire, s’étant trouvé dans la capitale, il seconda le général Bonaparte de tout son pouvoir. On sait que de pareils services ne furent jamais oubliés de celui-ci. Aussitôt après son triomphe, il donna à Moncey le commandement de la 15e division militaire, à Lyon. Moncey, par l’aménité de son caractère, la modération de son autorité, la prudence des mesures et des actes de son administration, s’y concilia l’amitié, l’estime de tout le monde. Au moment de la campagne d’Italie (1799-1800), Moncey fut envoyé commander un corps d’armée issu de l’aile droite de l’armée du Rhin. Tandis que l’armée principale gravissait le col du Grand-Saint-Bernard, on lui avait ordonné d’amener, à petites journées, ces 20 000 hommes depuis la frontière de la Suisse par le Saint-Gothard.
Le 17 mai 1800, à la tête de ses hommes, Moncey, rivalisant de courage avec le plus simple de ses soldats, s’élança sur les escarpements du terrible col. Débouchant par les vallées du Tyrol, ce corps prit part à l’invasion de la Lombardie. Le 22 mai, il s’était emparé de Bellinzona ; la veille, Monzambano lui avait ouvert ses portes ; le lendemain , il occupait Locarno et Lugano par des postes avancés. Le 28, il était à Milan. Au mois de juillet, alors que l’armée allait prendre position à Marengo, le général Moncey fut chargé d’occuper Plaisance, d’où il devait observer Bobbio, garder le Tessin, la Sesia et l’Oglio, depuis le confluent de cette rivière jusqu’au Pô, pousser en outre des reconnaissances sur Peschiera et Mantoue. Ces mouvements, combinés avec ceux des divisions Chabran, Lapoype et un détachement laissé à Ivrée, avaient pour but d’empêcher l’ennemi soit de pénétrer en Toscane pour se porter sur Gênes, soit de tenter le passage du Pô et du Tessin pour gagner Mantoue ou se faire jour par la rive droite du Pô, en combattant notre armée, soit enfin de se renfermer dans Turin. Lors de l’armistice qui suivit l’immortelle journée de Marengo, l’armée de gauche, aux ordres du général Moncey, occupa la Valteline.
A Roveredo, il fit un grand nombre de prisonniers, après avoir battu les Autrichiens à la Chiusa, à la Corona, à Serravalle. En dépit des généraux du Tyrol italien et quelques efforts qu’ils fissent, il parvint à opérer sa jonction avec Macdonald et l’armée dite des Grisons. Cette opération, d’une grande importance, fut même si rapidement exécutée, que l’ennemi continua de manouvrer pendant cinq jours, tant il était loin d’en supposer le succès. Dans la campagne suivante, en 1801, chargé du commandement de l’aile gauche de l’armée sous la direction de Brune, il se porte sur le village de Monzambano, dont il s’empare après une action très vive, où il eut un cheval tué sous lui. Ce succès était important en ce qu’il ouvrait à l’armée entière le passage du Mincio. L’ennemi, battu à Pozzuolo, à Valleggio, à Salionzo, se replia sur l’Adige. L’armée française l’y suivit en passant l’Adige à Bussolengo.
Le général en chef autrichien Bellegarde se porte sur Vicence, pour attendre l’arrivée des généraux Laudon et Vukasovic (de), qui descendaient du Tyrol avec des renforts. Brune ordonna à Moncey de se porter sur Trente pour y faire sa jonction avec Macdonald : le résultat de cette manouvre devait être d’isoler le corps autrichien de Laudon, de le cerner et de le tailler en pièces. Ce résultat allait être obtenu quand Laudon se tira du mauvais pas à l’aide d’une supercherie indigne d’un soldat. Il envoya au général français un officier de son état-major pour lui annoncer qu’il venait de recevoir la nouvelle certaine d’un armistice conclu entre leurs chefs respectifs Brune et Bellegarde, et pour demander de conclure une convention semblable. Le loyal Moncey, ne soupçonnant pas que cet avis fût un piège, accorda la suspension d’armes demandée, et Laudon lui échappa en défilant pendant la nuit sur la passe étroite de Caldonazzo, où il eût été écrasé.
Brune, informé de cette nouvelle, se hâta de démentir l’assertion du général autrichien, mais il était trop tard. Furieux de voir manquer son plan, il enlèva le commandement à Moncey, et envoya Davoust pour le remplacer, mais ce dernier, par respect pour son collègue, se contenta de prendre le commandement de la cavalerie, et l’armée entière, indignée de la mauvaise foi de Laudon, précipita sa marche pour en tirer vengeance. Elle allait l’atteindre quand les plénipotentiaires autrichiens se présentèrent à Brune en proposant un armistice aux conditions imposées par Bonaparte. Après la paix de Lunéville (1801), il eut le commandement militaire des provinces de l’Oglio et de l’Adda, converties en départements français. Commandement qu’il garda jusqu’au 3 décembre 1801, époque à laquelle le premier consul l’appela à Paris pour lui confier les fonctions d’inspecteur général de la gendarmerie.
Inspecteur-général de la gendarmerie
En 1801, il fut rappelé à Paris pour y exercer les fonctions d’inspecteur de gendarmerie. Ce nouvel emploi l’ayant amené dans la capitale, son crédit auprès du Premier Consul augmenta beaucoup. Dès lors il fut chargé de diriger une de ses nombreuses polices, ce qui lui était très facile par le moyen de la gendarmerie. Dans cette nouvelle position, Moncey se montra ce qu’il avait été sur les champs de bataille, intelligent, honnête, laborieux, dévoué. Moncey accompagna en 1803 Bonaparte dans son voyage des Pays-Bas. C’est à partir de cette époque (1803) que Jannot de Moncey occupa le château de Baillon à Asnières-sur-Oise ; lequel lui avait été donné par Napoléon Ier : auprès des armes de Moncey encore visibles au frontispice, on peut lire ces mots : « Le château de Baillon a été donné par l’empereur Napoléon au maréchal duc de Conegliano. »
En 1804 il présida le collège électoral du département du Doubs, et fut élu candidat au sénat conservateur par le département des Basses-Pyrénées, qui avait gardé souvenir de sa belle campagne de 1794. Le 19 mai 1804, Napoléon, devenu empereur, le comprit parmi les dix-huit généraux élevés au rang de maréchaux de l’empire. Le 2 décembre 1804, lors du sacre de Napoléon Ier, au milieu des autres maréchaux, debout sur les marches de l’autel, Moncey portait la corbeille du manteau de l’Impératrice Joséphine. Il fut créé grand-cordon (2 février 1805) et chef de la 11e cohorte de la Légion d’honneur. Duc de Conegliano depuis le 2 juillet 1808, Moncey restait chargé alors de commandements militaires de seconde ligne. Durant les campagnes d’Allemagne, Napoléon, désireux de conserver pendant son absence à l’intérieur quelques chefs sûrs et dévoués, laissa Moncey à Paris pour y continuer ses fonctions d’inspecteur général de la gendarmerie.
Campagne d’Espagne (1808-1809)
Moncey prit cependant une part active à la campagne d’Espagne en 1808 et 1809. En 1808, lorsque l’Empereur voulut faire occuper le trône d’Espagne par un membre de sa famille, le maréchal Moncey, à la tête de 24 000 hommes, passa de nouveau la Bidassoa et alla avec le gros de son armée établir son quartier-général à Burgos ; une de ses divisions gagna la Navarre et un certain nombre de bataillons se portèrent en Biscaye. On sait par quel coup de main les généraux français se rendirent maîtres de la citadelle de Pampelune, de Barcelone, de Cadix, de Madrid, du fort San Fernando et de la place de Saint-Sébastien. L’abdication de Charles IV et de son fils l’infant Ferdinand causèrent un mouvement insurrectionnel général en Espagne.
La guerre commença par des massacres. Aux premiers symptômes du soulèvement, les troupes françaises qui stationnaient sur les différents points de la Biscaye, de la Navarre, de la Catalogue, du royaume de Léon, de la vieille et de la nouvelle Castille et de l’Aragon, se mirent en mesure d’en comprimer le développement. Le corps d’observation des côtes de l’Océan, composé de 24 650 hommes, fut mis aux ordres du maréchal Moncey. L’émeute de Madrid du 2 mai avait été comme un signal auquel toutes les provinces s’étaient empressées de répondre ; le royaume de Valence était en armes au mois de juin. Le général Caro y avait pris le commandement en chef de l’insurrection et n’avait rien négligé de tout ce qui pouvait lui donner une attitude formidable ; il se trouvait à la tête d’un corps de 25 000 hommes bien équipés et parfaitement disciplinés. Joachim Murat chargea le maréchal Moncey de dissiper cet attroupement. Le maréchal, s’étant mis en mouvement dans la province de Tolède, où ses troupes étaient alors cantonnées, s’avança, par la province de Cuenca, sur le bourg de la Pesquera, situé dans cette même province, et où l’avant-garde du général Caro occupait une belle position, couvrant avec 4 pièces d’artillerie le pont de la rivière de Cabrial, à l’entrée d’un défilé. Malgré tous ces avantages, les Espagnols furent forcés à la baïonnette : le pont, le défilé, les canons, tout appartint aux Français. Un bataillon suisse et quelques gardes wallonnes passèrent du côté français. L’avant-garde ennemie se replia sur un autre corps intermédiaire, posté à Las Capreras, en avant du village de Siete Aguas, dans la province de Valence, sur la grande route de la ville de ce nom.
Cette position, déjà très forte par elle-même, fut soigneusement retranchée, et les Espagnols semblaient y défier le courage et l’audace des Français. Après une vigoureuse défense, l’ennemi, culbuté, battit en retraite, reculant de mamelon en mamelon, mais se défendant toujours ; il fut mis enfin en déroute, avec perte de 1 500 hommes, de 12 pièces de canon, et d’une quantité considérable de munitions et de bagages. L’armée française continua sa marche sur Valence, suivant la trace des fuyards. Ceux-ci se réunirent au gros des leurs, que le général Caro avait posté en avant de la ville, à deux lieues environ, derrière un canal, avec une batterie de 5 pièces de canon, qui défendaient le pont jeté sur le Guadalaviar, dont le feu croisait la grande route au village de Quarte. Les Espagnols avaient même coupé le pont pour plus de sûreté.
Le maréchal fit avancer son artillerie, qui démonta leurs pièces ; il forma plusieurs colonnes d’attaques qui, frappant sur plusieurs points le front de l’armée ennemie, y jeta le désordre et la terreur. La batterie fut enlevée, et la déroute des Espagnols si complète, qu’ils ne purent se rallier. Le maréchal Moncey fit rétablir le pont pendant la nuit pour y faire passer ses troupes, et dès le lendemain, 28 juin, il se porta sur Valence. L’attaque de cette ville offrait de grandes difficultés, défendue qu’elle était par la population entière, qui avait fait serment de l’incendier plutôt que de la rendre aux Français, et abritée d’ailleurs par de bonnes murailles, dont une multilude de canons rendaient l’abord très difficile. Pour rendre la résistance plus vigoureuse, les habitants avaient retranché les faubourgs qui s’étendent jusqu’à ses portes. Moncey fit lui-même la reconnaissance de cette ville et en ordonna l’attaque. Tous les obstacles furent franchis, les faubourgs enlevés et jonchés de morts ; 20 pièces de canon tombèrent au pouvoir des Français : mais ses remparts, entourés de fossés pleins d’eau, la mettaient à couvert d’un coup de main. Le maréchal fut obligé d’attendre l’arrivée de quelques pièces de grosse artillerie ; il cantonna ses troupes dans les faubourgs et aux environs de la place. Deux jours après, il fut informé qu’un rassemblement de 5 à 6 000 insurgés se montrait sur la rive droite du Xuxar pour soulager Valence au moyen d’une diversion. Moncey prit aussitôt cette direction, et rencontra l’ennemi qui s’était retranché sur des hauteurs, le culbuta et le poussa jusqu’au col d’Almansa, sur la frontière du royaume de Murcie. Le 3 juillet, il le chassa de cette position et lui fit éprouver de grandes pertes.
Après cette expédition, le maréchal reprit le chemin de Valence. L’artillerie prise a l’ennemi venant renforcer la sienne, le mettait à même de réduire la place de Valence, mais il en fut empêché par les événements qui survinrent en Andalousie. 5 000 morts, 50 canons et 3 drapeaux furent le brillant résultat de cette courte campagne. Vainqueurs d’une partie des insurgés du royaume de Valence au défilé d’Almanza, les troupes françaises furent attaquées à l’improviste en retour par le général Caro. Saisies d’une frayeur panique, elles ne combattirent point avec leur résolution accoutumée. Vainement les généraux firent-ils les plus grands efforts pour ramener l’ordre dans les rangs désorganisés, il leur fut impossible de rétablir le combat : plus de 1 000 hommes de toutes les armes perdirent la vie dans ce fâcheux désordre. La populace de Valence, qui avait suivi le général Caro dans son mouvement, exerça les plus cruelles indignités sur les cadavres des malheureux soldats. À son retour à Valence, elle continua ses excès en assassinant non seulement tous les Français qui s’y trouvèrent prisonniers, mais encore tous ceux des Espagnols que leur conduite antérieure rendait suspects aux chefs de l’insurrection. Le maréchal Moncey ayant rallié ses troupes dans la position de San Clémente, se préparait à prendre une revanche terrible, lorsqu’il reçut ordre de se rapprocher de Madrid. Au mois d’août il repassa l’Èbre, et vint se joindre aux différents corps qui s’étaient repliés sur ce point lors de la défection du général La Romana. Ses troupes, formant la gauche de la ligne d’opération, bordaient la rive droite de l’Aragon ; il avait établi son quartier-général à Tafalla. Deux succès récents avaient relevé le courage des Espagnols et ranimé leur enthousiasme, de toutes parts ils prenaient l’initiative, et la fortune semblait les conduire.
Le 25 octobre, des détachements de l’armée du général Castaños occupèrent Viana et Lerín. Le maréchal Moncey, voyant quelques-unes de ses positions menacées, fit avancer les brigades aux ordres des généraux Mabert et Razout, et celle de cavalerie du général Wathier, pour arrêter les Espagnols dans ce mouvement offensif et reprendre les postes occupés. L’ennemi, attaqué vigoureusement, fut culbuté et mis en déroute : 1 200 hommes, entourés dans Lérin, furent forcés de mettre bas les armes : 1 colonel, 2 lieutenants-colonels, 40 officiers et 1 200 vieux soldats, appartenant aux troupes de ligne qui avaient été tirées du camp de Saint-Roch, tombèrent au pouvoir des Français. Resté sous les murs de Valence, il ne fut pas plus heureux dans son attaque contre Saragosse, défendue par le brave Palafox. Il se distingua néanmoins d’une manière particulière lors de ce siège où il faillit être tué par un moine.Après la bataille de Tudela, si fatale aux Espagnols, le maréchal Moncey commanda le 3e corps d’armée employé au second siège et à la prise de la ville de Saragosse, défendue alors par le général espagnol Palafox, 35 à 40 000 hommes de troupes réglées, environ 15 000 paysans bien armés et la totalité de la population.
Tous les jours que Moncey passa devant les murs de cette place furent marqués par une victoire. Toutes les positions favorables au siège avaient été prises, les tranchées ouvertes, lorsque le maréchal, rappelé en France, dut remettre son commandement au duc d’Abrantès (2 janvier 1809). En septembre de la même année 1809, l’Angleterre ayant porté la guerre sur les côtes de la Hollande, Moncey fut envoyé en Flandre pour prendre le commandement de l’armée d’observation qui établit ses cantonnements dans le pays d’Hulst, d’Axel et de Cadzand. Il y fit face aux Anglais qui débarquaient à Walcheren. Après le désastre de cette expédition, Moncey rentra en France en 1811 où il eut à organiser des divisions de réserve destinées à l’armée du Nord. Napoléon ne lui confia plus que des commandements de réserve, avec la direction de la gendarmerie, ce qui fut toujours considéré comme l’un des plus grands moyens de son gouvernement. Moncey avait pour cela des pouvoirs très étendus ; il disposait de sommes considérables et ne rendait compte qu’à l’empereur lui-même. C’était en quelque façon le contrôleur, le surveillant de la police de Fouché et de celle de tous les départements, de tous les préfets, qui le surveillaient à leur tour. Il fut ainsi initié aux secrets les plus importants, et la confiance que le maître eut en lui dut être absolue.
Barrière de Clichy
Quand fut résolue la fatale campagne de Russie (1812), il fut un des généraux qui manifestèrent le plus ouvertement leur improbation. Napoléon, qui n’aimait pas à être contredit, ne l’appela point à prendre part à cette campagne. On sait quelle suite de revers signalèrent les années 1812 et 1813. Toutefois l’Empereur nomma Moncey, le 11 janvier 1814, major-général, commandant en second de la garde nationale de Paris.
Napoléon Ier lui dit en partant pour sa campagne d’hiver : « C’est à vous et au courage de la garde nationale que je confie l’impératrice et le roi de Rome… » En réponse à ce témoignage de confiance, Moncey remit à l’empereur une adresse, au nom de la garde nationale, qui ne fut pas une vaine déclamation, mais des promesses et des protestations de dévouement, auxquelles on ne peut nier qu’il ne soit pas resté fidèle, autant que les évènements le lui permirent.Il organisa avec beaucoup de zèle la garde nationale. Le jour décisif arriva le 30 mars 1814. Il disposait de quelques mille hommes. Il les disposa sur les hauteurs de Belleville et des Batignolles. Il tint aussi longtemps qu’il put contre l’écrasante supériorité numérique des alliés, et combattit avec une bravoure héroïque sur la place Clichy, où se dresse aujourd’hui sa statue (édifiée en 1870). On le vit à la tête des plus braves donner l’exemple du courage et ne cesser de combattre que quand la capitulation, qui fut préparée et signée par le duc de Raguse, eut forcé tout le monde à déposer les armes. Un ordre impératif obligea Moncey de suivre l’armée : il remit au duc de Montmorency le commandement de la garde nationale, et, réunissant aux Champs-Élysées les débris des troupes de ligne restées sans chefs, il se retira avec elles à Fontainebleau pour les mettre sous les ordres de l’empereur. On sait quelles furent bientôt les conséquences de la défection de Marmont, puis la déchéance et l’abdication de Napoléon. Le 11 avril, de retour à Paris, il fit connaître au gouvernement provisoire l’adhésion du corps de la gendarmerie, qu’il avait reçue la veille, et donna également la sienne dans une lettre adressée au prince de Bénévent.
Trois jours après il revint à Paris, se présenta à Monsieur, comte d’Artois, et fut bientôt nommé par le gouvernement royal, ministre d’État (13 mai 1814), chevalier de Saint-Louis (2 juin 1814), pair de France (4 du même mois), et maintenu dans ses fonctions de premier inspecteur-général de la gendarmerie. Il alla, ainsi que les autres maréchaux qui se trouvaient à Paris, au-devant de Louis XVIII, dans les premiers jours du mois de mai, et fut particulièrement distingué par ce prince, qui lui dit les choses les plus flatteuses. Moncey parut dès lors s’être soumis aux Bourbons avec autant de franchise que de loyauté. Le 9 mars 1815, informé que Napoléon revenait de l’île d’Elbe et débarquait au golfe Juan, Moncey s’empressa d’adresser aux gendarmes une proclamation leur rappelant simplement le serment qu’ils avaient prêté au roi. Il n’en fut pas moins nommé Pair à la « Chambre impériale », le 2 juin 1815, accepta cette dignité, mais ne prit aucune part à la campagne de Belgique (1815) et n’exerça aucun commandement actif. Au retour de Gand, Louis XVIII, pour le punir de cette condescendance, le priva de ses droits à la pairie par l’ordonnance du 24 juillet 1815. Nommé, en août 1815, président du conseil de guerre chargé de juger le maréchal Ney, il refusa cette fonction par une lettre, adressée au roi, pleine de noblesse et restée célèbre :
Sire
«Votre Majesté daignera-t-elle me permettre d’élever ma faible voix jusqu’à elle ? Sera-t-il permis à celui qui ne dévia jamais du sentier de l’honneur d’appeler l’attention de son souverain sur les dangers qui menacent sa personne et le repos de l’État ? Placé dans la cruelle alternative de désobéir à Votre Majesté ou de manquer à ma conscience, j’ai du m’expliquer à Votre Majesté ; je n’entre pas dans la question de savoir si le maréchal Ney est innocent ou coupable ; votre justice et l’équité de ses juges en répondront à la postérité, qui pèse dans la même balance les rois et les sujets… Sont-ce les alliés qui exigent que la France immole ses citoyens tes plus illustres ? Mais Sire, n’y a-t-il aucun danger pour votre personne et votre dynastie à leur accorder ce sacrifice ? D’abord ils se sont présentés en alliés ; mais les habitants de l’Alsace, de la Lorraine et de votre capitale même, quels noms doivent-ils leur donner ? Ils ont demandé la remise des armes. Dans les pays qu’ils occupent maintenant et dans les deux tiers de votre royaume, il ne reste pas même un fusil de chasse ! Ils ont voulu que l’armée française fût licenciée, et il ne reste plus un seul homme sous les drapeaux, pas un caisson attelé ! Il semble qu’un tel excès de condescendance a dû assouvir leur vengeance. Mais non ; ils veulent vous rendre odieux à vos sujets en faisant tomber, soit parmi les maréchaux, soit dans les armées, les têtes de ceux dont ils ne peuvent prononcer le nom sans rappeler leur humiliation. Ma vie, ma fortune, tout ce que j’ai de plus cher est à mon pays et à mon roi ; mais mon honneur est à moi ; aucune puissance humaine ne peut me le ravir. Qui, moi ! j’irais prononcer sur le sort du maréchal Ney ! Mais, Sire, permettez-moi de le demander à Votre Majesté, où étaient les accusateurs tandis que Ney parcourait les champs de bataille ? Ah ! si la Russie et les alliée ne peuvent pardonner au vainqueur de la Moskowa, la France peut-elle oublier le héros de la Bérésina ? Et j’enverrais à la mort celui auquel tant de Français doivent la vie, tant de familles leurs fils, leurs époux, leurs parents ! Réfléchissez-y, Sire ; c’est peut-être pour la dernière fois que la vérité parvient jusqu’à votre trône ; il est bien dangereux, bien impolitique, de pousser des braves au désespoir. Ah ! peut-être si le malheureux Ney avait fait à Waterloo ce qu’il fit tant de fois ailleurs, peut-être ne serait-il point traîné devant une commission militaire. Peut-être ceux qui demandent aujourd’hui sa mort imploreraient sa protection[…] »Votre Majesté daignera-t-elle me permettre d’élever ma faible voix jusqu’à elle ? Sera-t-il permis à celui qui ne dévia jamais du sentier de l’honneur d’appeler l’attention de son souverain sur les dangers qui menacent sa personne et le repos de l’État ? Placé dans la cruelle alternative de désobéir à Votre Majesté ou de manquer à ma conscience, j’ai du m’expliquer à Votre Majesté ; je n’entre pas dans la question de savoir si le maréchal Ney est innocent ou coupable ; votre justice et l’équité de ses juges en répondront à la postérité, qui pèse dans la même balance les rois et les sujets… Sont-ce les alliés qui exigent que la France immole ses citoyens tes plus illustres ? Mais Sire, n’y a-t-il aucun danger pour votre personne et votre dynastie à leur accorder ce sacrifice ? D’abord ils se sont présentés en alliés ; mais les habitants de l’Alsace, de la Lorraine et de votre capitale même, quels noms doivent-ils leur donner ? Ils ont demandé la remise des armes. Dans les pays qu’ils occupent maintenant et dans les deux tiers de votre royaume, il ne reste pas même un fusil de chasse ! Ils ont voulu que l’armée française fût licenciée, et il ne reste plus un seul homme sous les drapeaux, pas un caisson attelé ! Il semble qu’un tel excès de condescendance a dû assouvir leur vengeance. Mais non ; ils veulent vous rendre odieux à vos sujets en faisant tomber, soit parmi les maréchaux, soit dans les armées, les têtes de ceux dont ils ne peuvent prononcer le nom sans rappeler leur humiliation. Ma vie, ma fortune, tout ce que j’ai de plus cher est à mon pays et à mon roi ; mais mon honneur est à moi ; aucune puissance humaine ne peut me le ravir. Qui, moi ! j’irais prononcer sur le sort du maréchal Ney ! Mais, Sire, permettez-moi de le demander à Votre Majesté, où étaient les accusateurs tandis que Ney parcourait les champs de bataille ? Ah ! si la Russie et les alliée ne peuvent pardonner au vainqueur de la Moskowa, la France peut-elle oublier le héros de la Bérésina ? Et j’enverrais à la mort celui auquel tant de Français doivent la vie, tant de familles leurs fils, leurs époux, leurs parents ! Réfléchissez-y, Sire ; c’est peut-être pour la dernière fois que la vérité parvient jusqu’à votre trône ; il est bien dangereux, bien impolitique, de pousser des braves au désespoir. Ah ! peut-être si le malheureux Ney avait fait à Waterloo ce qu’il fit tant de fois ailleurs, peut-être ne serait-il point traîné devant une commission militaire. Peut-être ceux qui demandent aujourd’hui sa mort imploreraient sa protection »
Ce refus le fit destituer de sa dignité de maréchal, par ordonnance royale du 29 août de la même année, et il fut en même temps envoyé pour trois mois aux arrêts à la forteresse de Ham. Là, la tragédie tourne à la farce. Le commandant prussien du fort de Ham refuse d’emprisonner un maréchal d’Empire. Qu’à celà ne tienne, Moncey loue une chambre à l’auberge située en face de la citadelle. Et chaque soir, sur ordre des officiers Prussiens, la troupe…lui donnait l’aubade ! Eloigné du pouvoir, rejetté par les royalistes, il reste sans emploi. Il vit dans son chateau de Baillon près de Luzarches. D’après la Biographie universelle ancienne et moderne, la volonté royale n’avait eu aucune part à la condamnation de Ney, car aussitôt que le mouvement de réaction et d’orage fut passé, le roi se hâta de rendre toute sa faveur à Moncey.Remis en grâce auprès du roi, le 5 mars 1816, il fut réintégré dans le titre de son duché. Moncey prêta serment entre les mains du roi, en qualité de maréchal de France, le 14 juillet 1816. Éliminé de la Chambre haute après le second retour du roi, il n’y rentra qu’à la grande promotion, dite fournée des 60, le 5 mars 1819, par suite de la « proposition Barthélemy » On se rappelle qu’il fut, en 1819, l’un des fondateurs de la société pour l’amélioration des prisons. L’année suivante (5 avril 1820), Moncey devint en outre gouverneur de la 9e division militaire, et le 30 septembre chevalier de l’ordre du Saint-Esprit.
Retour des cendres de l’Empereur
Lors de la cérémonie funéraire du retour des cendres de Napoléon Ier, qui eut lieu dans l’église Saint-Louis-des-Invalides le 15 décembre 1840, Moncey, quoique malade, pouvant à peine se mouvoir, et malgré la rigueur d’un froid excessif, voulut rendre un dernier hommage à son bienfaiteur, à celui qu’il avait servi avec tant de zèle, de loyauté. Déjà gravement malade avant l’arrivée du cercueil, il aurait déclaré à son médecin : « docteur, faites-moi vivre encore un peu, je veux recevoir l’Empereur. » On le portait dans un fauteuil, il fut placé dans le chour, à gauche de l’autel, auprès du catafalque et là, immobile, muet, ce fantôme de soldat, en grande tenue militaire, attendit l’arrivée du cadavre de Napoléon. Lorsque l’illustre corps fit son entrée dans l’église, le vieillard voulut se lever, les forces lui manquèrent, il retomba sur son fauteuil. Un éclair d’émotion passa sur ce visage déjà marqué de l’empreinte de la mort. Il se fit transporter jusqu’au cercueil, embrassa la poignée de l’épée de Napoléon et déclara : « à présent rentrons mourir ». Il vécut encore quelque temps après ce jour solennel, et mourut à l’Hôtel des Invalides, le 20 avril 1842, à onze heures du soir. Soult prononça son discours funèbre, le maréchal Oudinot lui succéda aux Invalides.
Napoléon déclare à son sujet : « Moncey était un honnête homme ». Le maréchal Soult dit quant à lui : « Moncey est le modèle de toutes les vertus ».
